L'actionnariat salarié, un dispositif en pleine ascension dans les grandes entreprises
Le Panorama 2025 d’Eres dresse le portrait d’un capitalisme plus participatif que jamais. En 2024, 37 entreprises du SBF 120 ont mené 43 opérations d’actionnariat salarié, dont 38 augmentations de capital, 3 cessions d’actions et 2 opérations mixtes. Ce volume marque le plus haut niveau observé depuis la création du baromètre.
Le montant total souscrit atteint 4,71 milliards d’euros, soit plus du double du niveau observé dix ans plus tôt. En moyenne, chaque salarié participant a investi 5.943 euros, un chiffre en hausse de 9% sur un an. Cette dynamique confirme l’intérêt croissant des salariés pour un dispositif qui leur permet de devenir partie prenante du succès de leur entreprise.
Les entreprises du SBF 120 affichent ainsi un rythme soutenu : en moyenne, une opération collective est réalisée tous les deux ans. Depuis 2014, plus de 385 opérations ont été recensées, représentant 35 milliards d’euros d’augmentation de capital. Une ampleur qui témoigne du rôle stratégique pris par l’actionnariat salarié dans les politiques de gestion des talents et de fidélisation.
Le montant total souscrit atteint 4,71 milliards d’euros, soit plus du double du niveau observé dix ans plus tôt. En moyenne, chaque salarié participant a investi 5.943 euros, un chiffre en hausse de 9% sur un an. Cette dynamique confirme l’intérêt croissant des salariés pour un dispositif qui leur permet de devenir partie prenante du succès de leur entreprise.
Les entreprises du SBF 120 affichent ainsi un rythme soutenu : en moyenne, une opération collective est réalisée tous les deux ans. Depuis 2014, plus de 385 opérations ont été recensées, représentant 35 milliards d’euros d’augmentation de capital. Une ampleur qui témoigne du rôle stratégique pris par l’actionnariat salarié dans les politiques de gestion des talents et de fidélisation.
Une démocratisation accélérée : 2,4 millions de salariés actionnaires
L’un des enseignements majeurs du Panorama est la progression constante du nombre de salariés actionnaires. En 2024, ils sont près de 2,4 millions à détenir des parts dans leur entreprise, soit plus d’un tiers des effectifs du SBF 120. La proportion de capital détenue par les salariés s’élève à 3% en moyenne, confirmant la progression de ce mode de participation à la gouvernance.
Autre signe de maturité : 30% des entreprises disposent désormais d’un représentant des salariés au conseil d’administration, le plus haut taux jamais observé depuis 2014. Cette présence accrue renforce la voix des collaborateurs dans les décisions stratégiques et traduit un engagement durable envers la participation au capital. « Dans le SBF 120, un salarié actionnaire détient en moyenne près de 32.000 euros, soit le prix d’un véhicule neuf de type berline », commente Mathieu Chauvin, président d’Eres. Cet ordre de grandeur illustre la place croissante de l’épargne salariale dans le patrimoine financier des ménages.
Autre signe de maturité : 30% des entreprises disposent désormais d’un représentant des salariés au conseil d’administration, le plus haut taux jamais observé depuis 2014. Cette présence accrue renforce la voix des collaborateurs dans les décisions stratégiques et traduit un engagement durable envers la participation au capital. « Dans le SBF 120, un salarié actionnaire détient en moyenne près de 32.000 euros, soit le prix d’un véhicule neuf de type berline », commente Mathieu Chauvin, président d’Eres. Cet ordre de grandeur illustre la place croissante de l’épargne salariale dans le patrimoine financier des ménages.
Des salariés gagnants, un levier puissant de fidélisation
La performance du dispositif conforte cette tendance. Selon Eres, les salariés ont été gagnants dans 82% des cas sans abondement et dans 93% des cas lorsque leur entreprise proposait un abondement de 100%. Pour 1.000 euros investis, le gain moyen atteint +79% sur cinq ans, et jusqu’à +238% avec abondement et dividendes.
Prolongée sur neuf ans — soit l’ancienneté moyenne observée dans le SBF 120 — la rentabilité atteint des niveaux remarquables : +151% à +356%, selon les scénarios. Ces performances s’expliquent par la combinaison d’un horizon de placement long, de prix décotés et d’abondements avantageux. En 2024, la décote moyenne s’établit à 19,3%, tandis que 75% des entreprises ont proposé une réduction d’au moins 20% sur le prix de souscription.
Cette attractivité renforce la fidélisation : le taux de départ volontaire chute à 8,1% dans les entreprises dotées d’une forte culture d’actionnariat salarié, contre 12,1% dans celles où il reste marginal. De même, l’ancienneté moyenne atteint 9,7 ans, contre 7,2 ans dans les entreprises à faible participation. Ces écarts significatifs démontrent le rôle social et managérial de ce mécanisme, devenu un outil de cohésion interne autant qu’un levier financier.
Prolongée sur neuf ans — soit l’ancienneté moyenne observée dans le SBF 120 — la rentabilité atteint des niveaux remarquables : +151% à +356%, selon les scénarios. Ces performances s’expliquent par la combinaison d’un horizon de placement long, de prix décotés et d’abondements avantageux. En 2024, la décote moyenne s’établit à 19,3%, tandis que 75% des entreprises ont proposé une réduction d’au moins 20% sur le prix de souscription.
Cette attractivité renforce la fidélisation : le taux de départ volontaire chute à 8,1% dans les entreprises dotées d’une forte culture d’actionnariat salarié, contre 12,1% dans celles où il reste marginal. De même, l’ancienneté moyenne atteint 9,7 ans, contre 7,2 ans dans les entreprises à faible participation. Ces écarts significatifs démontrent le rôle social et managérial de ce mécanisme, devenu un outil de cohésion interne autant qu’un levier financier.
Le BTP et la finance, champions de la participation au capital
En termes d'actionnariat salarié, certaines branches se distinguent particulièrement. Le BTP reste le fer de lance de l’actionnariat salarié. Les employés du secteur détiennent en moyenne 11,3% du capital de leur entreprise, contre 3% pour la moyenne du SBF 120. Bouygues, Eiffage et Vinci comptent parmi les pionniers : leurs salariés détiennent respectivement 22%, 21% et 11% du capital. En 2024, les groupes du BTP ont réalisé six opérations pour un montant total de 1,15 milliard d’euros, soit un quart du volume total de l’année.
« L’actionnariat salarié fait partie intégrante de la culture d’entreprise dans le BTP », rappelle Mathieu Chauvin, le président d’Eres. « Les entreprises du secteur figurent parmi les plus avancées, tant par la fréquence des opérations que par l’ampleur des montants levés. » L’année 2024 l’a illustré avec un plan collectif record de 685 millions d’euros, le plus important de l’année.
Les assurances, banques et services financiers suivent à distance, avec des taux de détention parmi les plus élevés du classement, tandis que les secteurs de la technologie et du luxe restent plus en retrait. Cette diversité témoigne d’une appropriation sectorielle progressive, chaque domaine adaptant le dispositif à ses propres enjeux de capital et de gouvernance.
« L’actionnariat salarié fait partie intégrante de la culture d’entreprise dans le BTP », rappelle Mathieu Chauvin, le président d’Eres. « Les entreprises du secteur figurent parmi les plus avancées, tant par la fréquence des opérations que par l’ampleur des montants levés. » L’année 2024 l’a illustré avec un plan collectif record de 685 millions d’euros, le plus important de l’année.
Les assurances, banques et services financiers suivent à distance, avec des taux de détention parmi les plus élevés du classement, tandis que les secteurs de la technologie et du luxe restent plus en retrait. Cette diversité témoigne d’une appropriation sectorielle progressive, chaque domaine adaptant le dispositif à ses propres enjeux de capital et de gouvernance.
Actionnariat salarié : la France en tête en Europe
À l’échelle européenne, la France demeure le leader incontesté de l’actionnariat salarié coté. D’après les données partagées par la Fédération européenne de l’actionnariat salarié (FEAS) et reprises par Eres, près de 79% des entreprises françaises cotées proposent un plan collectif, contre 59% en moyenne dans le reste de l’Europe. Le taux de démocratisation atteint 31,6%, largement devant le Royaume-Uni (27%) et les autres grandes économies.
Cette avance s’explique par un cadre législatif favorable — notamment la possibilité de décote jusqu’à 30% — et par une culture d’entreprise qui valorise la participation au capital comme un élément de la stratégie sociale.
Les observateurs notent également une corrélation entre la performance économique et la présence d’actionnaires salariés : selon les analyses d’Eres, les sociétés ayant déployé régulièrement des plans sur la période 2014–2024 affichent des niveaux de productivité et de fidélité plus élevés que la moyenne de l’indice.
Cette avance s’explique par un cadre législatif favorable — notamment la possibilité de décote jusqu’à 30% — et par une culture d’entreprise qui valorise la participation au capital comme un élément de la stratégie sociale.
Les observateurs notent également une corrélation entre la performance économique et la présence d’actionnaires salariés : selon les analyses d’Eres, les sociétés ayant déployé régulièrement des plans sur la période 2014–2024 affichent des niveaux de productivité et de fidélité plus élevés que la moyenne de l’indice.
Vers une maturité sociale du capitalisme français
L’ensemble des indicateurs souligne une mutation profonde du management dans les grandes entreprises. L’actionnariat salarié n’est plus perçu comme un simple outil d’épargne, mais comme un levier de gouvernance, de motivation et de stabilité. Les entreprises qui associent leurs collaborateurs au capital constatent non seulement une meilleure rétention des talents, mais aussi un alignement plus fort entre stratégie et engagement interne.
En 2024, le SBF 120 compte désormais des millions de salariés investisseurs, des gains financiers tangibles et un ancrage social durable. Les dirigeants, de plus en plus nombreux à recourir à ces dispositifs, y voient une réponse concrète aux défis de fidélisation et d’attractivité du marché du travail.
En 2024, le SBF 120 compte désormais des millions de salariés investisseurs, des gains financiers tangibles et un ancrage social durable. Les dirigeants, de plus en plus nombreux à recourir à ces dispositifs, y voient une réponse concrète aux défis de fidélisation et d’attractivité du marché du travail.
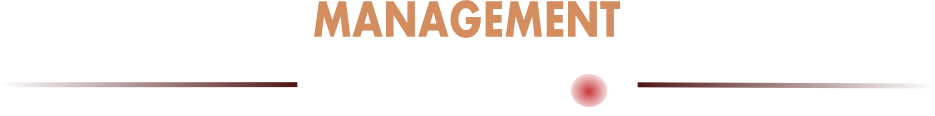
 Entreprise
Entreprise




