Les décès au lieu de travail atteignent un niveau inédit en 2024
L’Assurance maladie vient de publier son rapport annuel 2024 sur les risques professionnels, confirmant un record de décès sur le lieu de travail en France. Selon ses données, 1.297 personnes sont mortes en lien direct avec leur travail en 2024, faisant du décès professionnel un enjeu central de santé publique, de sécurité au travail et de responsabilité managériale. En 2024, 764 décès ont été directement imputables à des accidents du travail. À ces décès s’ajoutent 318 morts liées aux accidents de trajet, ainsi que 215 décès causés par des maladies professionnelles, pour atteindre un total de 1 297 décès liés au travail sur un an.
Ce bilan prend toute sa dimension lorsque l’on rappelle qu’il ne couvre que les salariés du régime général, c’est-à-dire le secteur privé. Les exploitants agricoles, les indépendants et une grande partie des agents publics ne sont pas inclus dans cette comptabilité, ce qui signifie que le nombre réel de décès liés au lieu de travail est probablement plus élevé.
Dans le même temps, le nombre total d’accidents du travail reconnus connaît une baisse. En 2024, 549.614 accidents du travail ont été comptabilisés. Cette contradiction apparente révèle une mutation profonde des risques : moins d’accidents au global, mais davantage de décès, et donc une gravité accrue des situations rencontrées sur le lieu de travail.
Ce bilan prend toute sa dimension lorsque l’on rappelle qu’il ne couvre que les salariés du régime général, c’est-à-dire le secteur privé. Les exploitants agricoles, les indépendants et une grande partie des agents publics ne sont pas inclus dans cette comptabilité, ce qui signifie que le nombre réel de décès liés au lieu de travail est probablement plus élevé.
Dans le même temps, le nombre total d’accidents du travail reconnus connaît une baisse. En 2024, 549.614 accidents du travail ont été comptabilisés. Cette contradiction apparente révèle une mutation profonde des risques : moins d’accidents au global, mais davantage de décès, et donc une gravité accrue des situations rencontrées sur le lieu de travail.
Les principaux facteurs de décès : malaises, maladies professionnelles et secteurs à risque
L’analyse qualitative des décès montre que la plupart ne résultent pas d’évènements spectaculaires, mais de causes internes au corps humain. À en croire le Rapport annuel 2024 de l’Assurance maladie, plus de la moitié des accidents du travail mortels font suite à des malaises. Ces malaises mortels renvoient directement à la question de la santé des travailleurs, de leur suivi médical, mais aussi des contraintes physiques et psychiques imposées par le travail. Dans ses travaux récents reposant sur la base EPICEA, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) souligne que ces malaises concernent « presque exclusivement des hommes » et que l’âge médian des victimes se situe autour de 51 ans, confirmant la vulnérabilité accrue des salariés vieillissants exposés à des conditions de travail dégradées.
Parallèlement, les maladies professionnelles poursuivent leur progression. En 2024, leur nombre a augmenté de 6,7% par rapport à 2023, selon le rapport de l’Assurance maladie. Cette hausse est portée par trois grandes catégories de pathologies : les troubles musculosquelettiques, en augmentation de 6,6%, les pathologies liées à l’amiante, en hausse de 8,5%, et surtout les affections psychiques, en progression de 9%. Ces évolutions confirment une dégradation de la santé mentale au travail, désormais pleinement intégrée dans les statistiques de décès indirects liés à l’activité professionnelle.
Sur le plan sectoriel, les inégalités face au décès restent très marquées. Les métiers des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication concentrent à eux seuls 178 décès en 2024, soit une hausse de 13% par rapport à 2023. Le secteur du BTP, historiquement à haut risque, enregistre quant à lui 146 décès, en légère baisse de 2% sur un an. Cette évolution ne signifie pas que les risques y disparaissent, mais qu’ils se recomposent autour d’autres formes d’exposition.
Ces données montrent que les décès sur le lieu de travail ne sont pas répartis de manière homogène. Ils se concentrent dans certaines branches fortement exposées, où la sécurité, les cadences, les infrastructures et l’organisation du travail jouent un rôle déterminant.
Parallèlement, les maladies professionnelles poursuivent leur progression. En 2024, leur nombre a augmenté de 6,7% par rapport à 2023, selon le rapport de l’Assurance maladie. Cette hausse est portée par trois grandes catégories de pathologies : les troubles musculosquelettiques, en augmentation de 6,6%, les pathologies liées à l’amiante, en hausse de 8,5%, et surtout les affections psychiques, en progression de 9%. Ces évolutions confirment une dégradation de la santé mentale au travail, désormais pleinement intégrée dans les statistiques de décès indirects liés à l’activité professionnelle.
Sur le plan sectoriel, les inégalités face au décès restent très marquées. Les métiers des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication concentrent à eux seuls 178 décès en 2024, soit une hausse de 13% par rapport à 2023. Le secteur du BTP, historiquement à haut risque, enregistre quant à lui 146 décès, en légère baisse de 2% sur un an. Cette évolution ne signifie pas que les risques y disparaissent, mais qu’ils se recomposent autour d’autres formes d’exposition.
Ces données montrent que les décès sur le lieu de travail ne sont pas répartis de manière homogène. Ils se concentrent dans certaines branches fortement exposées, où la sécurité, les cadences, les infrastructures et l’organisation du travail jouent un rôle déterminant.
Moins d’accidents mais plus de décès : le paradoxe du travail contemporain
Le paradoxe de l’année 2024 tient à l’écart grandissant entre la baisse des accidents et la hausse des décès. L’indice de fréquence des accidents du travail, c’est-à-dire le nombre d’accidents pour 1.000 salariés, s’établit à 26,4 en 2024, en baisse de 1,1% par rapport à 2023. Cette tendance pourrait, en théorie, traduire une amélioration globale de la sécurité sur le lieu de travail.
Cependant, la progression des décès démontre que cette amélioration est partielle, voire inégale. Les accidents sont moins nombreux, mais lorsqu’ils surviennent, ils sont plus souvent mortels. Cette évolution interroge les transformations profondes du travail : intensification des tâches, allongement de la durée de vie professionnelle, pressions psychiques croissantes, pénurie de main-d’œuvre, dégradation de certaines conditions matérielles.
Le poids économique de cette mortalité est également considérable. En 2024, 4,901 milliards d’euros d’indemnités journalières ont été versées au titre des arrêts de travail liés aux accidents du travail et maladies professionnelles, selon le Rapport annuel 2024 de l’Assurance maladie. Ce montant traduit l’ampleur du système de réparation, mais aussi la gravité des atteintes à la santé des salariés.
À l’échelle européenne, la situation française s’inscrit dans une tendance préoccupante. Selon Eurostat, 3.298 accidents mortels au travail ont été recensés dans l’Union européenne en 2023, ce qui permet de situer le poids des décès français dans un contexte continental marqué par des écarts importants entre pays, selon les structures économiques et les normes de sécurité.
Les données de la DARES, relatives aux années précédentes, confirment par ailleurs la baisse du nombre global d’accidents du travail reconnus, ce qui renforce le caractère anormal de la hausse des décès observée en 2024. Cette dissociation entre accidentologie et mortalité suggère que les risques professionnels évoluent vers des formes plus insidieuses, moins visibles, mais plus létales.
Cependant, la progression des décès démontre que cette amélioration est partielle, voire inégale. Les accidents sont moins nombreux, mais lorsqu’ils surviennent, ils sont plus souvent mortels. Cette évolution interroge les transformations profondes du travail : intensification des tâches, allongement de la durée de vie professionnelle, pressions psychiques croissantes, pénurie de main-d’œuvre, dégradation de certaines conditions matérielles.
Le poids économique de cette mortalité est également considérable. En 2024, 4,901 milliards d’euros d’indemnités journalières ont été versées au titre des arrêts de travail liés aux accidents du travail et maladies professionnelles, selon le Rapport annuel 2024 de l’Assurance maladie. Ce montant traduit l’ampleur du système de réparation, mais aussi la gravité des atteintes à la santé des salariés.
À l’échelle européenne, la situation française s’inscrit dans une tendance préoccupante. Selon Eurostat, 3.298 accidents mortels au travail ont été recensés dans l’Union européenne en 2023, ce qui permet de situer le poids des décès français dans un contexte continental marqué par des écarts importants entre pays, selon les structures économiques et les normes de sécurité.
Les données de la DARES, relatives aux années précédentes, confirment par ailleurs la baisse du nombre global d’accidents du travail reconnus, ce qui renforce le caractère anormal de la hausse des décès observée en 2024. Cette dissociation entre accidentologie et mortalité suggère que les risques professionnels évoluent vers des formes plus insidieuses, moins visibles, mais plus létales.
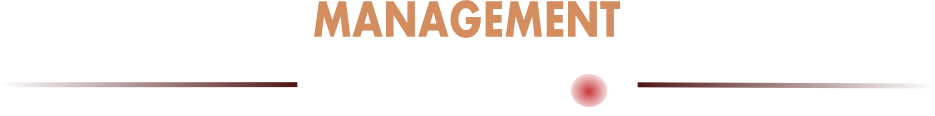
 Entreprise
Entreprise




