L’absentéisme a encore progressé de 3% en 2024
C'est une tendance préoccupante que révèle le Baromètre de l'absentéisme dans le privé réalisé par la société de courtage d’assurance et de réassurance Willis Towers Watson France (WTW). Le taux d’absentéisme a atteint 5,1% en 2024, en hausse de 3% sur un an, confirmant une progression constante depuis 2019. L’absentéisme est désormais une préoccupation majeure pour les ressources humaines, avec des arrêts de travail plus longs et plus fréquents qui touchent durablement l’organisation des salariés et l’équilibre des équipes.
Depuis 2019, le taux d’absentéisme a bondi de 34%. Cette évolution traduit un changement structurel et durable. « Il y a clairement un avant et un après Covid avec des indicateurs qui ont tous dérivé de façon importante : +13% pour la prévalence, +14% pour la durée moyenne », peut-on lire dans ce rapport. La prévalence atteint désormais 35%, ce qui signifie qu’un salarié sur trois a été arrêté au moins une fois au cours de l’année. Les arrêts de travail deviennent également plus longs : la durée moyenne atteint 24 jours, contre 21 avant 2020.
Les arrêts de longue durée, supérieurs à 90 jours, pèsent de plus en plus lourd dans l’absentéisme. Ils représentent 57% du total en 2024, contre 48% en 2019. Cette aggravation est en grande partie liée aux risques psychosociaux, devenus la première cause des arrêts longs. « Les risques psychosociaux restent la première cause d’absentéisme des arrêts longs et contribuent à l’augmentation du taux d’absentéisme », confirment les auteurs du rapport. En 2024, les troubles mentaux représentent 36% de ces absences prolongées, contre 32% en 2023. Cette évolution témoigne d’un malaise croissant, qui interroge les pratiques managériales et les conditions de travail.
Depuis 2019, le taux d’absentéisme a bondi de 34%. Cette évolution traduit un changement structurel et durable. « Il y a clairement un avant et un après Covid avec des indicateurs qui ont tous dérivé de façon importante : +13% pour la prévalence, +14% pour la durée moyenne », peut-on lire dans ce rapport. La prévalence atteint désormais 35%, ce qui signifie qu’un salarié sur trois a été arrêté au moins une fois au cours de l’année. Les arrêts de travail deviennent également plus longs : la durée moyenne atteint 24 jours, contre 21 avant 2020.
Les arrêts de longue durée, supérieurs à 90 jours, pèsent de plus en plus lourd dans l’absentéisme. Ils représentent 57% du total en 2024, contre 48% en 2019. Cette aggravation est en grande partie liée aux risques psychosociaux, devenus la première cause des arrêts longs. « Les risques psychosociaux restent la première cause d’absentéisme des arrêts longs et contribuent à l’augmentation du taux d’absentéisme », confirment les auteurs du rapport. En 2024, les troubles mentaux représentent 36% de ces absences prolongées, contre 32% en 2023. Cette évolution témoigne d’un malaise croissant, qui interroge les pratiques managériales et les conditions de travail.
Un impact différencié selon les salariés et les secteurs
Le Baromètre nous apprend par ailleurs que l’absentéisme ne touche pas tous les salariés de la même manière. Les femmes enregistrent un taux d’absentéisme plus élevé que les hommes : 6,1%, contre 4,6%. Ce différentiel s’explique par une combinaison de facteurs, parmi lesquels une exposition plus forte à certaines pathologies, mais aussi des contraintes familiales et sociales. À l’inverse, les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) sont beaucoup moins absents. Leur taux d’absentéisme est deux fois inférieur à celui des salariés en contrat à durée indéterminée (CDI), en raison notamment de la crainte de ne pas voir leur contrat renouvelé.
Les disparités sont également sectorielles. L’hébergement-restauration enregistre le taux d’absentéisme le plus élevé, avec 8,5% en 2024. Il est suivi par les transports et la santé, secteurs où les conditions de travail, les horaires atypiques et l’exposition à des charges physiques ou psychologiques renforcent la fréquence des arrêts de travail. Par ailleurs, les accidents du travail et maladies professionnelles ne représentent que 6% des arrêts, mais comptent pour 17% des jours d’absentéisme. Leur durée est en moyenne trois fois plus longue que celle des arrêts maladie classiques : 71 jours contre 21.
Les disparités sont également sectorielles. L’hébergement-restauration enregistre le taux d’absentéisme le plus élevé, avec 8,5% en 2024. Il est suivi par les transports et la santé, secteurs où les conditions de travail, les horaires atypiques et l’exposition à des charges physiques ou psychologiques renforcent la fréquence des arrêts de travail. Par ailleurs, les accidents du travail et maladies professionnelles ne représentent que 6% des arrêts, mais comptent pour 17% des jours d’absentéisme. Leur durée est en moyenne trois fois plus longue que celle des arrêts maladie classiques : 71 jours contre 21.
Un coût massif pour les entreprises françaises
Au-delà des conséquences humaines et organisationnelles, l’absentéisme pèse lourdement sur la performance économique des entreprises. Selon le baromètre, son coût direct annuel est estimé à 120 milliards d’euros pour l’ensemble du secteur privé. Cette facture intègre non seulement le maintien de salaire et les compléments employeurs, mais aussi le coût indirect lié au remplacement des salariés absents, à la désorganisation des équipes et à la baisse de productivité. Le poids des arrêts longs accentue cette tendance, puisque leur durée étendue entraîne une désorganisation durable des services.
La combinaison d’une prévalence en hausse, d’une durée moyenne plus longue et du poids croissant des risques psychosociaux constitue un défi majeur pour les directions des ressources humaines. Les entreprises françaises doivent désormais repenser leurs politiques de prévention, renforcer le suivi médical et adapter leurs dispositifs d’accompagnement des salariés. Car si les arrêts de travail traduisent un état de santé dégradé, ils sont aussi le symptôme d’une organisation qui doit évoluer pour contenir un phénomène dont l’impact ne cesse de croître.
La combinaison d’une prévalence en hausse, d’une durée moyenne plus longue et du poids croissant des risques psychosociaux constitue un défi majeur pour les directions des ressources humaines. Les entreprises françaises doivent désormais repenser leurs politiques de prévention, renforcer le suivi médical et adapter leurs dispositifs d’accompagnement des salariés. Car si les arrêts de travail traduisent un état de santé dégradé, ils sont aussi le symptôme d’une organisation qui doit évoluer pour contenir un phénomène dont l’impact ne cesse de croître.
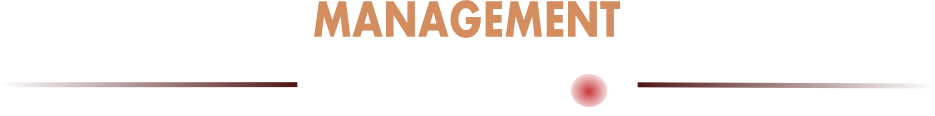
 Entreprise
Entreprise




