Une décision de la Cour de cassation qui bouleverse le droit du travail
Jusqu’ici, selon la jurisprudence française établie depuis 1996, si un salarié tombait malade pendant ses congés payés, ces jours de congé étaient considérés comme consommés, même s’il ne pouvait pas en profiter. Mais dans le pourvoi n° 23-22.732, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que « dès lors qu’un salarié placé en arrêt maladie pendant ses congés payés a notifié à son employeur cet arrêt, il a le droit de les voir reportés ». Cette décision inscrit la jurisprudence française en conformité avec le droit de l’Union européenne, notamment l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE, qui exige que le congé annuel payé permette réellement un repos, distinct de l’arrêt de travail pour maladie.
Avec ce revirement, les employeurs doivent adapter leurs pratiques immédiatement. Voici les obligations à connaître :
- Reconnaître le droit au report. Si un salarié est en arrêt maladie pendant ses congés payés et qu’il avertit l’employeur de cet arrêt, les jours de congé correspondant ne doivent pas être imputés sur son solde de congés.
- Exiger une notification. Le droit au report est subordonné à une condition : le salarié doit notifier l’arrêt de travail à l’employeur. Sans notification, le salarié ne pourra pas exiger le report.
- Adapter les procédures internes. Vos procédures RH doivent être revues pour distinguer les jours de congés réellement posés et ceux pendant lesquels le salarié est en arrêt maladie. Il faut que le suivi des absences soit précis, que les plannings et les soldes de congés reflètent cette distinction.
- Informer les salariés. Il est conseillé de communiquer clairement à tous les salariés ce nouveau droit : conditions, modalités, démarches à suivre. Cela réduit les risques de malentendus et de contentieux.
- Gérer les contentieux potentiels. Des salariés pourraient solliciter le report rétroactivement, voire engager des démarches judiciaires si le droit n’est pas respecté. Anticiper les demandes et vérifier les pratiques passées peut éviter des surprises financières.
Avec ce revirement, les employeurs doivent adapter leurs pratiques immédiatement. Voici les obligations à connaître :
- Reconnaître le droit au report. Si un salarié est en arrêt maladie pendant ses congés payés et qu’il avertit l’employeur de cet arrêt, les jours de congé correspondant ne doivent pas être imputés sur son solde de congés.
- Exiger une notification. Le droit au report est subordonné à une condition : le salarié doit notifier l’arrêt de travail à l’employeur. Sans notification, le salarié ne pourra pas exiger le report.
- Adapter les procédures internes. Vos procédures RH doivent être revues pour distinguer les jours de congés réellement posés et ceux pendant lesquels le salarié est en arrêt maladie. Il faut que le suivi des absences soit précis, que les plannings et les soldes de congés reflètent cette distinction.
- Informer les salariés. Il est conseillé de communiquer clairement à tous les salariés ce nouveau droit : conditions, modalités, démarches à suivre. Cela réduit les risques de malentendus et de contentieux.
- Gérer les contentieux potentiels. Des salariés pourraient solliciter le report rétroactivement, voire engager des démarches judiciaires si le droit n’est pas respecté. Anticiper les demandes et vérifier les pratiques passées peut éviter des surprises financières.
Arrêt maladie pendant les congés : des zones d'ombre subsistent
Même si la décision est limpide sur le principe, des zones d’ombre subsistent, notamment :
- Modalités de notification : quel délai pour informer ? Quelle forme doit prendre la notification (certificat médical, transmission papier ou numérique) ?
- Prescription : jusqu’à quand un salarié peut-il demander le report ? Le délai de prescription des droits salariaux en général est de trois années selon l’article L. 3245-1 du Code du travail.
- Conventions collectives : certaines prévoient déjà des règles plus favorables. Il faudra veiller à leur compatibilité et à leur application.
- Coût pour l’entreprise : reports de congés, ajustements de paie, charges administratives, formation des managers… Ces coûts sont à anticiper.
Ainsi, l’arrêt du 10 septembre 2025 change le paysage pour les employeurs : un arrêt maladie pendant les congés payés ne peut plus entraîner la perte automatique des jours de congé non utilisés, à condition que le salarié informe l’employeur. Vos politiques internes, vos outils RH et la communication interne doivent évoluer pour intégrer ce nouveau droit.
- Modalités de notification : quel délai pour informer ? Quelle forme doit prendre la notification (certificat médical, transmission papier ou numérique) ?
- Prescription : jusqu’à quand un salarié peut-il demander le report ? Le délai de prescription des droits salariaux en général est de trois années selon l’article L. 3245-1 du Code du travail.
- Conventions collectives : certaines prévoient déjà des règles plus favorables. Il faudra veiller à leur compatibilité et à leur application.
- Coût pour l’entreprise : reports de congés, ajustements de paie, charges administratives, formation des managers… Ces coûts sont à anticiper.
Ainsi, l’arrêt du 10 septembre 2025 change le paysage pour les employeurs : un arrêt maladie pendant les congés payés ne peut plus entraîner la perte automatique des jours de congé non utilisés, à condition que le salarié informe l’employeur. Vos politiques internes, vos outils RH et la communication interne doivent évoluer pour intégrer ce nouveau droit.
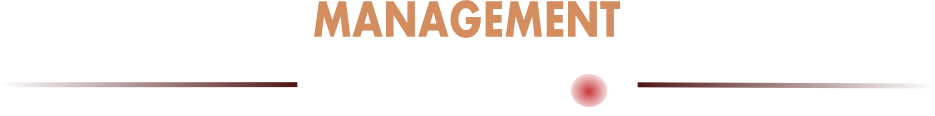
 Entreprise
Entreprise




