Prévenir avant de punir : une verbalisation systématique des risques
Chaque jour en France, plus de deux personnes meurent en exerçant leur activité professionnelle. À ces chiffres glaçants s’ajoutent plus d’une centaine de blessés graves. Un bilan d’autant plus insupportable que, depuis 2010, il ne baisse plus. Pis, il s’installe dans une forme d’acceptabilité morbide.
Fini les avertissements sans suite. Désormais, même en l’absence d’accident, l’Inspection du travail est invitée à verbaliser les infractions graves aux règles de sécurité. Risques de chute, protections défaillantes, absence de formation des intérimaires ou des jeunes : la simple exposition d’un salarié à un danger majeur suffira à justifier une procédure.
L’objectif est clair : couper court aux pratiques déviantes avant que le drame ne survienne. « Les accidents du travail graves et mortels ne sont pas des statistiques mais des vies, des familles et des collectifs de travail brisés », a déclaré Astrid Panosyan-Bouvet, ministre chargée du Travail et de l’Emploi. Et d’insister : « Ils ne sont pas une fatalité ».
Fini les avertissements sans suite. Désormais, même en l’absence d’accident, l’Inspection du travail est invitée à verbaliser les infractions graves aux règles de sécurité. Risques de chute, protections défaillantes, absence de formation des intérimaires ou des jeunes : la simple exposition d’un salarié à un danger majeur suffira à justifier une procédure.
L’objectif est clair : couper court aux pratiques déviantes avant que le drame ne survienne. « Les accidents du travail graves et mortels ne sont pas des statistiques mais des vies, des familles et des collectifs de travail brisés », a déclaré Astrid Panosyan-Bouvet, ministre chargée du Travail et de l’Emploi. Et d’insister : « Ils ne sont pas une fatalité ».
Responsabiliser toute la chaîne, pas seulement l’employeur
C’est une des révolutions discrètes du texte : pour la première fois, l’instruction exige que tous les acteurs de la chaîne de commandement puissent être poursuivis, y compris les maîtres d’ouvrage ou donneurs d’ordre. Une reconnaissance juridique implicite d’un fait souvent tu : les responsabilités sont rarement isolées.
Le Code du travail prévoit déjà des obligations pour ces acteurs. Mais dans les faits, les sanctions se concentrent le plus souvent sur les seuls chefs d’entreprise. Cette époque semble révolue. Le parquet pourra désormais cosaisir l’Inspection du travail et les services de police judiciaire, afin d’accélérer les enquêtes et de renforcer la lisibilité de la réponse pénale. Pour Gérald Darmanin, ministre de la Justice, cette approche marque une inflexion stratégique : « La cosaisine […] est un exemple de concrétisation opérationnelle en vue de concourir à la manifestation de la vérité ».
Le Code du travail prévoit déjà des obligations pour ces acteurs. Mais dans les faits, les sanctions se concentrent le plus souvent sur les seuls chefs d’entreprise. Cette époque semble révolue. Le parquet pourra désormais cosaisir l’Inspection du travail et les services de police judiciaire, afin d’accélérer les enquêtes et de renforcer la lisibilité de la réponse pénale. Pour Gérald Darmanin, ministre de la Justice, cette approche marque une inflexion stratégique : « La cosaisine […] est un exemple de concrétisation opérationnelle en vue de concourir à la manifestation de la vérité ».
Accompagner les victimes, réparer, humaniser
Ce n’est pas seulement une affaire de répression. Le troisième pilier de l’instruction est l’accompagnement des victimes et de leurs familles. L’État demande aux parquets de s’appuyer davantage sur les associations d’aide, pour offrir un suivi digne aux proches, dès les premières heures.
L’Inspection du travail devra également informer systématiquement sur les voies de réparation, en orientant les familles vers les unités médico-sociales et les structures adaptées. Là encore, il s’agit de sortir du silence et de donner corps à la justice sociale dans sa dimension humaine, pas uniquement pénale. « Cette instruction […] marque un tournant : celui d’une action publique mieux coordonnée, plus ferme, et plus humaine », a résumé Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles.
L’Inspection du travail devra également informer systématiquement sur les voies de réparation, en orientant les familles vers les unités médico-sociales et les structures adaptées. Là encore, il s’agit de sortir du silence et de donner corps à la justice sociale dans sa dimension humaine, pas uniquement pénale. « Cette instruction […] marque un tournant : celui d’une action publique mieux coordonnée, plus ferme, et plus humaine », a résumé Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles.
Un signal envoyé aux secteurs les plus à risque
Le bâtiment, l’industrie, l’agriculture : ces secteurs concentrent une majorité des drames. Un rapport publié en novembre 2024 par l’Assurance maladie soulignait déjà que les métiers du BTP restaient les plus meurtriers de France. Les nouvelles mesures s’adressent à eux au premier chef. Et le signal est limpide : la justice ne se contentera plus d’intervenir a posteriori. La prévention est requalifiée en urgence pénale, la négligence en délit passible de sanctions immédiates, y compris en l’absence d’accident.
Il faut le souligner : cette instruction ne crée pas de nouveaux outils juridiques. Elle propose une réactivation énergique de mécanismes existants — verbalisation, transaction pénale, cosaisine, audiences coordonnées. Mais elle leur donne une force d’impact politique et judiciaire inédite. En somme, l’État change de ton. Là où la loi dormait dans les manuels, elle s’invite désormais dans les chantiers, les entrepôts et les bureaux.
Il faut le souligner : cette instruction ne crée pas de nouveaux outils juridiques. Elle propose une réactivation énergique de mécanismes existants — verbalisation, transaction pénale, cosaisine, audiences coordonnées. Mais elle leur donne une force d’impact politique et judiciaire inédite. En somme, l’État change de ton. Là où la loi dormait dans les manuels, elle s’invite désormais dans les chantiers, les entrepôts et les bureaux.
Une justice plus rapide, plus large, plus visible
Le véritable défi ne sera pas législatif mais opérationnel. Comment les parquets, déjà engorgés, parviendront-ils à traiter ces infractions avec la réactivité requise ? Comment les DREETS s’assureront-elles que les transactions pénales débouchent sur des changements concrets ? Le 13 juin 2025, un séminaire de coordination entre les ministères de la Justice et du Travail a permis de poser les premières briques de cette coopération. Des témoignages d’inspecteurs, de magistrats, de responsables territoriaux ont illustré les pratiques possibles.
La France change-t-elle de paradigme en matière de santé au travail ? L’instruction du 10 juillet 2025 promet en tout cas un changement de méthode : réagir plus vite, viser plus juste, protéger mieux.
La France change-t-elle de paradigme en matière de santé au travail ? L’instruction du 10 juillet 2025 promet en tout cas un changement de méthode : réagir plus vite, viser plus juste, protéger mieux.
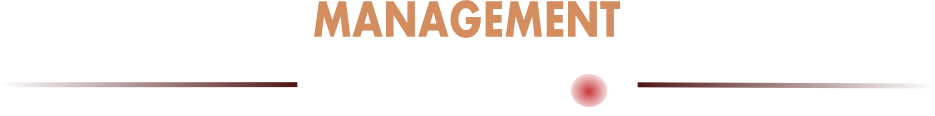
 Entreprise
Entreprise




